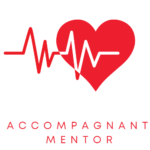Blessure de rejet : Comprendre et guérir la peur d’être rejetée
(Femme Triste Seule – Photo gratuite sur Pixabay) Une femme assise parmi d’autres mais se sentant seule et rejetée, illustrant la souffrance intérieure de la blessure de rejet.
Qu’est-ce que la blessure de rejet ?
La blessure de rejet est une blessure émotionnelle profonde qui se crée lorsque l’on se sent, de façon récurrente et marquante, repoussé(e), mis(e) à l’écart ou non désiré(e) par les autres. Contrairement à un simple épisode de rejet que tout le monde peut connaître un jour, cette blessure s’installe dans la durée et touche au cœur de l’estime de soi. La personne en vient à croire qu’elle ne mérite pas d’exister ou qu’elle n’a pas de valeur aux yeux d’autrui. Ce sentiment dévastateur peut survenir dans tous les domaines de vie : en amour, en famille, dans le cercle d’amis ou au travail (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?) (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?).
« Celui qui souffre de rejet se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d’exister », expliquait Lise Bourbeau, auteure du livre Les cinq blessures qui empêchent d’être soi-même. Cette phrase résume bien la profondeur de cette blessure : la personne ne se sent pas simplement refusée sur un point précis, elle a l’impression que tout son être est nié ou exclu.
Intention de recherche : En découvrant la notion de blessure de rejet, vous cherchez sans doute à comprendre pourquoi vous souffrez tant de la peur d’être rejetée et comment vous en libérer. Peut-être avez-vous entendu parler des 5 blessures de l’âme de Lise Bourbeau, ou bien vous avez identifié des schémas répétitifs de rejet dans votre vie. Dans tous les cas, cet article ultra-complet va vous aider à définir cette blessure, en reconnaître les signes, et découvrir des pistes pour commencer à la guérir.
Nota Bene : La blessure de rejet est souvent inconsciente ou refoulée (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). Beaucoup de personnes en souffrent sans mettre de mot dessus, se disant juste “hypersensibles au rejet” ou “trop à fleur de peau”. Si en vous lisant vous ressentez des émotions fortes ou des souvenirs douloureux, sachez que c’est normal. Prenez le temps d’assimiler les informations, et n’hésitez pas à vous faire accompagner d’un professionnel si besoin (psychologue, thérapeute). Votre bien-être émotionnel est précieux – et aborder ces sujets montre déjà votre courage et votre désir d’aller mieux. 💗
Origines et causes : D’où vient la blessure de rejet ?
La blessure de rejet prend souvent racine dans l’enfance. C’est l’une des premières blessures émotionnelles qui peut survenir chez un individu, parfois dès la petite enfance voire la naissance selon certaines théories (Je me sens rejeté, comment faire ?- Bulle de Bonheur) (Je me sens rejeté, comment faire ?- Bulle de Bonheur). Concrètement, elle naît lorsque l’enfant vit (ou perçoit) une situation où il se sent rejeté, non accepté ou indésirable par une figure importante pour lui – généralement un parent ou une personne proche.
Rejet réel ou perçu : Il est important de noter que le rejet à l’origine de la blessure peut être réel (objectif) ou ressenti (subjectif). Autrement dit, un parent n’a pas forcément voulu faire de mal, mais l’enfant a quand même ressenti un rejet. Par exemple, si vos parents vous confiaient souvent à la nounou et que, petit(e), vous l’avez vécu comme un abandon ou un éloignement non choisi, cela a pu semer la graine de la blessure. Ce qui compte, ce n’est pas tant l’intention de l’adulte que le vécu émotionnel de l’enfant.
Exemples de causes fréquentes dans l’enfance : Un bébé non désiré au départ, ou arrivé “par accident”, peut grandir avec le sentiment (même implicite) qu’il était de trop (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). De même, un enfant dont le sexe n’était pas celui attendu (“on voulait un garçon, pas une fille”) peut sentir qu’il ne correspond pas aux attentes et intérioriser un rejet (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). D’autres scénarios peuvent blesser profondément : des remarques blessantes ou méprisantes répétées, un parent très critique ou distant, des épisodes de maltraitance ou de négligence, ou encore la perte d’un être cher qui fait que l’enfant se sent abandonné puis rejette à son tour l’amour par peur de revivre une perte (La blessure de rejet : causes et caractéristiques) (La blessure de rejet : causes et caractéristiques).
Le rôle des parents et de l’attachement : Souvent, la blessure de rejet se développe en écho avec le parent du même sexe, selon Lise Bourbeau (La blessure de rejet : causes et caractéristiques) (Je me sens rejeté, comment faire ?- Bulle de Bonheur). L’explication donnée est que ce parent “miroir” est celui dont l’enfant attend une validation de son identité : si la petite fille se sent rejetée par sa mère, elle conclut qu’elle n’est “pas une bonne fille” ou “pas aimable en tant que femme”, et inversement pour le garçon avec son père. Cependant, ce schéma n’est pas systématique : tout enfant, garçon ou fille, peut développer une blessure de rejet vis-à-vis d’un parent qui a – volontairement ou non – envoyé des messages de rejet. Par exemple, un père très autoritaire qui dit à son fils « Tu n’es qu’un bon à rien ! » ou « Tu me déçois » peut, sans le savoir, créer chez lui cette douleur du rejet.
L’angoisse de séparation : Une cause fréquente mentionnée par les psychologues est l’angoisse de séparation vécue dans la petite enfance (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). Vers 8–9 mois, le bébé prend conscience qu’il est une personne distincte de sa mère, ce qui peut engendrer une grande anxiété lorsqu’il est séparé d’elle (même quelques instants). Si cette phase est mal accompagnée – par exemple, si la mère est absente ou si le contexte familial est insécurisant –, l’enfant peut en garder une peur de l’abandon ou du rejet. Plus tard, à l’adolescence, d’autres formes de rejet (moqueries à l’école, premiers chagrins d’amour, conflits familiaux) peuvent raviver ou creuser la blessure initiale (Je me sens rejeté, comment faire ?- Bulle de Bonheur) (Je me sens rejeté, comment faire ?- Bulle de Bonheur).
La personnalité et la sensibilité de l’enfant : Tous les enfants ne développent pas cette blessure de façon égale. L’hypersensibilité ou certaines vulnérabilités (enfants très émotifs, ou présentant des troubles du spectre autistique, etc.) peuvent rendre un enfant plus susceptible de se sentir rejeté même dans des situations où un autre enfant serait peu affecté (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). Par exemple, un enfant hypersensible pourrait vivre la moindre critique comme un rejet personnel. De plus, plus les expériences de rejet se répètent, plus la blessure s’aggrave (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). Un rejet isolé fait mal sur le moment, mais des rejets répétés (changements d’école multiples, rejets successifs par des pairs, déménagements qui coupent l’enfant de ses amis, etc.) peuvent ancrer l’idée “personne ne veut de moi”.
En résumé, la blessure de rejet naît d’une expérience (ou d’une accumulation d’expériences) où l’enfant s’est senti nié dans son besoin fondamental d’amour et d’acceptation. C’est souvent involontaire de la part de l’entourage : un mot maladroit, un manque de disponibilité, un événement tragique… Mais pour l’enfant, le résultat est le même : une profonde souffrance, souvent refoulée dans l’inconscient, qui influencera sa vie d’adulte tant qu’elle ne sera pas reconnue et « cicatrisée » (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?).
Comment reconnaître la blessure de rejet ? (Symptômes et comportements)
Vous vous demandez peut-être si vous souffrez, vous aussi, de la blessure de rejet. Certaines personnes en portent les traces sans le savoir, attribuant leurs difficultés à “pas de chance en amour” ou à un trait de caractère comme la timidité. Pourtant, plusieurs signes caractéristiques peuvent indiquer la présence de cette blessure en vous. Voici les principaux symptômes émotionnels et comportementaux de la blessure de rejet :
Un profond manque d’estime de soi
L’un des symptômes centraux de la blessure de rejet, c’est une faible estime de soi. La personne touchée se dévalorise énormément. Elle se voit comme “nulle”, “sans intérêt”, “pas importante” (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Souvent, elle a intégré l’idée « Si l’on m’a rejetée, c’est que je ne vaux rien ». Cela peut se traduire par des pensées négatives récurrentes : « Je suis un fardeau », « Ma présence dérange », « Je ne mérite pas qu’on m’aime ».
Ce manque d’estime vient du fait que l’enfant intérieur en nous, celui qui a souffert du rejet, a conclu qu’il y avait un problème avec lui. Au lieu de voir le rejet comme la conséquence des circonstances ou du comportement de l’autre, l’enfant (puis l’adulte) pense “c’est de ma faute, je ne suis pas assez bien”. Ainsi, à l’âge adulte, vous pouvez avoir du mal à accepter les compliments (“ils disent ça pour être polis”), ou au contraire vous excuser sans cesse de tout. Intérieurement, vous doutez de votre droit d’occuper une place. Dans un groupe, vous vous sentez souvent “en trop” ou invisible. Vous avez tendance à laisser les autres passer avant, à vous effacer, à éviter d’attirer l’attention – car au fond de vous, vous pensez ne pas mériter qu’on s’intéresse à vous.
L’hyper-sensibilité au rejet et la peur panique d’être exclue
Si vous souffrez de cette blessure, vous êtes probablement très sensible à la moindre marque de rejet, même anodine. Une critique au travail, un appel non retourné, un ami qui décline une invitation… et votre cœur s’emballe : « Ça y est, il/elle ne m’aime plus, je vais être abandonnée ». Bien souvent, vous interprétez négativement des situations neutres en pensant y voir du rejet (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Par exemple, si une amie met du temps à répondre à un message, vous imaginez avoir fait quelque chose de mal et vous ruminez : « Elle doit m’en vouloir, je l’ai certainement agacée, elle va me rayer de sa vie… ».
Cette peur constante d’être rejetée peut tourner à l’obsession dans l’esprit. On parle parfois de peur du rejet tout court, car elle finit par dicter beaucoup de vos actions ou inactions. La plus grande peur associée à la blessure de rejet est la panique : panique de ne plus être aimée, panique d’être un jour totalement seule (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Cette angoisse panique peut survenir dans des moments de conflit ou d’incertitude dans vos relations. Par exemple, si votre partenaire paraît distant un soir, vous ressentez une bouffée d’angoisse incontrôlable, avec des pensées catastrophiques du type « Il va me quitter, je ne pourrai pas le supporter ».
Le masque du « fuyant » : fuir pour ne pas être rejetée
Pour se protéger de cette peur viscérale du rejet, la personne va inconsciemment développer un masque (un mécanisme de défense). Dans le cas de la blessure de rejet, Lise Bourbeau parle du masque du fuyant (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Concrètement, cela signifie que vous avez tendance à fuir les situations où vous pourriez être rejetée. Cela peut prendre différentes formes :
Se rendre “invisible” : Le fuyant cherche à ne pas prendre de place pour ne pas risquer de décevoir ou d’être repoussé. Vous évitez de vous affirmer, vous ne donnez pas votre avis par peur qu’on le rejette. En groupe, vous vous tenez en retrait. Vous pouvez même avoir le réflexe de vous isoler socialement (beaucoup de personnes avec une blessure de rejet se définissent comme “solitaires”). Mieux vaut être seul par choix que rejeté par les autres – c’est du moins ce que croit la blessure en vous. Vous pouvez ainsi limiter vos interactions sociales, refuser des sorties, rester dans votre coin dès que vous vous sentez de trop. Paradoxalement, cette stratégie aggrave la solitude et le sentiment de rejet, mais sur le moment elle vous semble protectrice.
Rejeter les autres avant d’être rejetée soi-même : C’est un comportement fréquent, souvent inconscient. Par peur d’être quittée ou rejetée, vous prenez les devants et coupez les ponts dès que vous sentez un risque. Par exemple, si vous avez l’impression qu’une amie vous calcule moins, vous pouvez brusquement cesser de lui parler sans explication – en réalité parce que vous vous sentez rejetée et préférez inverser les rôles pour garder la face (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). De même en amour, vous pourriez mettre fin à une relation naissante dès que vous vous attachez trop, redoutant que l’autre finisse par vous blesser. Ce mécanisme de sabotage relationnel est tragique, car il vous prive de liens potentiellement sincères. C’est un peu “je te quitte avant que tu ne me quittes, comme ça je contrôle la douleur”.
Éviter toute confrontation ou conflit : Le fuyant craint les conflits car il les perçoit comme un rejet de sa personne. Ainsi, vous allez préférer vous taire et ravaler vos besoins plutôt que de risquer une dispute. Si quelqu’un hausse le ton, la panique monte en vous et vous cherchez une échappatoire (quitter la pièce, changer de sujet, vous excuser même si vous n’avez rien fait) (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Vous avez énormément de mal à dire “non” par peur de déplaire. Cette tendance à tout accepter peut mener à de la surcharge, de l’épuisement ou à subir des situations injustes – ce qui peut renforcer le sentiment de n’avoir aucune valeur (puisque vous ne posez pas de limites, certains peuvent en abuser).
Perfectionnisme excessif : Être parfait pour n’être critiqué sur rien – voilà une autre facette du masque. Beaucoup de personnes avec une blessure de rejet deviennent très perfectionnistes (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Elles se fixent des standards impossibles pour chaque tâche, pensant inconsciemment « si je suis irréprochable, on ne pourra pas me rejeter ». Cela peut se traduire par une grande exigence au travail, ou le fait de tout planifier pour éviter la moindre faute. Derrière le perfectionnisme, on retrouve la peur du jugement : « si je fais une erreur, on va me trouver nulle, donc me rejeter » (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Être occupée en permanence, travailler d’arrache-pied, peut aussi être un moyen pour le fuyant d’oublier sa souffrance et de se prouver qu’il a une utilité (ce qui combattrait son impression de ne pas exister). Attention cependant : cette quête de perfection est épuisante, génère du stress, et n’apporte jamais la validation recherchée (on ne peut pas plaire à tout le monde même en étant parfait, et surtout on a le droit d’être imparfait !).
Refuge dans l’imaginaire ou des comportements d’évitement : En lien avec la fuite, la personne peut développer des stratégies pour “quitter” la réalité temporairement : s’enfuir dans un monde imaginaire, rêvasser, lire énormément, jouer à des jeux vidéo des heures durant, voire avoir recours à des addictions (drogue, alcool, nourriture…) (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). Ce sont autant de façons de ne pas affronter le réel et les interactions sociales potentiellement douloureuses. Certains trouvent refuge dans la spiritualité ou l’intellectuel, en délaissant les contacts humains concrets (La blessure de rejet : causes et caractéristiques). D’autres encore peuvent somatiser : par exemple, développer des problèmes de peau ou des maux physiques flous, inconsciemment pour éviter le contact ou l’intimité (la peau est notre frontière avec les autres, la rendre “intouchable” est symboliquement une protection) (La blessure de rejet : causes et caractéristiques).
Des difficultés relationnelles et affectives marquées
En conséquence de tout cela, la blessure de rejet entraîne généralement des relations sociales et amoureuses compliquées. On observe souvent :
Sentiment de solitude : Même entourée, vous vous sentez seule ou différente. Vous avez l’impression de ne jamais réellement faire partie d’un groupe, d’être à côté. Vous pouvez avoir peu d’amis proches, ou bien des relations superficielles car vous n’osez pas vous dévoiler (de peur qu’en vous connaissant vraiment, ils vous rejettent). Il n’est pas rare de préférer la compagnie d’un animal ou la solitude, qui semblent moins risquées que l’amitié ou l’amour.
Vie amoureuse chaotique : Côté cœur, la blessure de rejet peut se manifester de deux manières opposées (parfois alternées) : soit vous évitez les relations sérieuses pour ne pas souffrir, soit vous vous accrochez à des partenaires indisponibles qui, justement, vous font revivre du rejet. Dans le premier cas, vous fuyez tout engagement : si quelqu’un vous plaît, vous n’osez pas faire le pas ou vous sabotez la relation naissante (vous disparaissez du jour au lendemain dès que ça devient sérieux, par exemple). Dans le second cas, vous tombez peut-être amoureuse de personnes qui ne veulent pas vraiment de vous (déjà en couple, émotionnellement indisponibles, ou qui vous traitent mal). Ce choix inconscient, c’est votre blessure qui le fait : en allant vers quelqu’un qui vous rejette (même partiellement), vous rejouez un schéma connu – dans l’espoir illusoire de le réparer un jour ou simplement parce que c’est ainsi que vous croyez mériter d’être traitée. Malheureusement, cela entretient la souffrance et peut même l’aggraver (accumulation de relations douloureuses, de ruptures non expliquées, etc.).
Hyper-réactivité émotionnelle : Dans vos relations, vous réagissez peut-être très fortement à des situations de rejet. On pourrait qualifier cela de “disproportionné” vu de l’extérieur, mais à l’intérieur la douleur est bien réelle. Par exemple, si votre conjoint oublie votre rendez-vous, vous le vivez comme un drame personnel (« Il s’en fiche de moi, je ne compte pas ») et vous pouvez exploser en larmes ou en colère, là où quelqu’un d’autre serait juste fâché sans douter de l’amour de l’autre. Cette réactivité peut surprendre votre entourage, voire les éloigner (ils ne comprennent pas pourquoi “une petite chose” vous met dans un tel état), ce qui crée un cercle vicieux : plus vous avez des réactions émotionnelles intenses, plus vous vous sentez incomprise et… rejetée à nouveau.
Dépendance affective ou phobie de l’attachement : Certaines personnes avec la blessure de rejet oscillent entre la peur de l’abandon et la peur de l’engagement. D’un côté, vous redoutez tellement qu’on vous quitte que vous pouvez devenir très (trop) collante, en demande d’attention constante, cherchant sans cesse à être rassurée sur l’amour qu’on vous porte. D’un autre côté, dès que quelqu’un s’approche vraiment de vous émotionnellement, cela réactive la peur profonde (« s’il me connaît vraiment, il va me rejeter »), et vous pourriez prendre la fuite ou ériger un mur. Cette ambivalence rend les relations amoureuses tumultueuses : votre cœur aspire à l’amour, mais votre blessure vous souffle de vous méfier de cet amour qui pourrait faire mal.
En lisant ces symptômes, peut-être vous reconnaissez-vous dans plusieurs d’entre eux. Chaque personne étant unique, la blessure de rejet peut s’exprimer différemment chez chacun. Mais généralement, le fil rouge, c’est un sentiment d’insécurité affective permanent. Toujours sur le qui-vive, vous scrutez les signes d’acceptation ou de rejet dans le regard des autres. C’est épuisant émotionnellement, et cela peut aussi impacter votre santé physique (stress chronique, anxiété, dépression, troubles du sommeil…).
Bonne nouvelle : Mettre le doigt sur ces comportements et émotions n’est pas une fin en soi, c’est le début du changement. En prenant conscience que ces réactions viennent d’une blessure ancienne, vous pouvez commencer à vous en libérer peu à peu. La suite de cet article va justement vous guider dans cette voie de guérison 💞. Avant cela, sachez que vous n’êtes pas “anormale” ou “condamnée” à souffrir toute votre vie. Des milliers de femmes (et d’hommes) ont vécu la même chose et s’en sont sorties renforcées. Vous aussi, vous le pouvez, à votre rythme.
Guérir de la blessure de rejet : 9 étapes pour s’apaiser et se reconstruire
La blessure de rejet est profonde, et soyons honnêtes : on ne l’efface pas d’un coup de baguette magique (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). Guérir, ici, ne veut pas dire “oublier complètement” ou “ne plus jamais avoir mal” ; il s’agit plutôt d’apprendre à vivre avec cette vulnérabilité sans qu’elle nous contrôle, de cicatriser la plaie pour qu’elle ne soit plus à vif. Vous allez transformer cette blessure en une force, ou du moins en une part de vous qui ne vous empêche plus d’aimer et d’être aimée. ✨
Prête à entamer ce voyage intérieur ? Voici 9 étapes clés et conseils concrets pour commencer à guérir votre blessure de rejet :
1. Prendre conscience de sa blessure (ôter le masque)
La première étape, et sans doute la plus cruciale, c’est de reconnaître l’existence de la blessure. Tant que vous niez ou refoulez votre souffrance, elle continuera d’agir dans l’ombre (via le fameux masque du fuyant, entre autres). Au contraire, en prenant conscience « Oui, j’ai cette blessure de rejet, elle me fait mal, et elle influence ma vie », vous faites un grand pas vers la guérison (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?).
Cette prise de conscience peut être bouleversante – un flot d’émotions peut surgir, de la tristesse, de la colère, de la peur. Accueillez ces émotions sans jugement. Vous avez le droit d’être blessée, et le droit d’en souffrir. Cela ne fait pas de vous quelqu’un de faible, mais au contraire quelqu’un de courageux qui ose regarder la réalité en face. Dites-vous bien que ce n’est pas votre faute si cette blessure existe (un enfant n’est jamais responsable du rejet qu’il subit), mais qu’il vous appartient désormais, en tant qu’adulte, de la prendre en charge pour ne plus la subir.
Un exercice simple pour cette étape : mettez des mots sur votre ressenti. Par exemple, écrivez dans un journal ou dites à voix haute : « Je me sens souvent rejetée. Cette peur du rejet me gâche la vie, j’aimerais m’en libérer. » Nommez la blessure : « C’est ma blessure de rejet qui me fait penser cela. » Rien que cela, c’est commencer à la désamorcer. Vous créez une distance entre vous (qui valez la peine d’être aimée) et la blessure (qui est un phénomène psychologique, pas votre identité).
2. Identifier l’origine de la blessure (l’enfant intérieur)
Une fois la blessure identifiée, il est très utile d’explorer son origine. En comprenant d’où elle vient, on peut donner du sens à nos émotions et commencer à les apaiser. Cela revient souvent à aller rencontrer votre enfant intérieur blessé.
Repensez à votre enfance : Y a-t-il un souvenir marquant de rejet ? Par exemple, vous souvenez-vous d’un moment où vous vous êtes senti(e) humiliée, rejetée, non écoutée ? Parfois, le simple fait d’y repenser peut réveiller des émotions enfouies. Peut-être que vous minimisez en vous disant “Oh ce n’est rien, d’autres ont vécu pire”. Mais écoutez la petite fille en vous : pour elle, c’était important. Honorez son ressenti.
Écriture thérapeutique : Prenez une feuille et racontez votre histoire (personne ne la lira, c’est pour vous). Parlez de votre naissance si vous en savez des choses (par ex. « Maman m’a eu à 18 ans, j’ai toujours senti qu’elle avait sacrifié des choses pour moi… »), de votre petite enfance, de vos parents. Notez les événements ou paroles qui ont pu vous blesser (déménagements, comparaisons avec un frère/une sœur, moqueries à l’école, etc.). Ce travail d’écriture peut faire surgir des liens : « Ah, c’est peut-être quand Papa partait longtemps pour le travail que j’ai commencé à me sentir abandonnée… » ou « Je réalise que j’ai cherché toute ma vie l’approbation de Maman, qui était si dure… ». Sans auto-censure, écrivez tout ce qui vous vient, même si cela vous semble décousu. Vous pourrez y voir plus clair ensuite (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?).
Parler aux personnes concernées (si possible) : Si vous en avez la possibilité et que la relation actuelle est bonne, discuter avec un parent ou un proche de cette époque peut apporter un éclairage. Par exemple, dire à votre mère : « Petite, je me suis sentie rejetée quand tu me confiais à Mamie le week-end. Comment toi tu voyais les choses ? » Parfois, entendre la version de l’adulte (ex : “J’étais épuisée, j’avais peur de mal faire, je pensais bien faire en te confiant à Maman”) peut aider à recontextualiser. Bien sûr, ce n’est pas toujours possible ou conseillé (si le parent est toxique ou déniant, cela peut vous blesser plus encore). À défaut de parler directement, vous pouvez écrire une lettre que vous n’enverrez pas, où vous exprimez tout ce que vous avez sur le cœur à la personne qui vous a fait ressentir du rejet. L’objectif n’est pas d’accuser, mais de libérer VOTRE vérité. Vous pouvez ensuite garder cette lettre, la brûler symboliquement, ou la lire à votre thérapeute – l’important est d’exprimer ce qui était tu.
Débusquer les non-dits et croyances familiales : Parfois, la blessure de rejet s’inscrit dans une histoire familiale plus large. Y a-t-il eu, par exemple, un schéma de rejet transmis (une lignée de femmes “fuyantes” ? un secret de famille d’enfant illégitime rejeté ?). Ce genre de loyautés invisibles peut faire porter à un enfant le fardeau de rejets passés. Ce point est plus complexe, mais en thérapie transgénérationnelle ou lors de constellations familiales, on découvre parfois que notre blessure ne nous appartient pas totalement. Cela peut soulager de le comprendre.
En identifiant l’origine, vous validez la raison d’être de votre blessure. Vous comprenez que oui, il y a eu de quoi avoir mal, et que votre réaction de protection (fuir, vous méfier) était logique à l’époque. Maintenant, l’adulte que vous êtes peut commencer à reconsidérer ces événements avec du recul et apporter à l’enfant intérieur l’amour et la sécurité qui ont manqué à ce moment-là.
3. Accueillir et exprimer ses émotions de rejet refoulées
Guérir passe par la libération émotionnelle. Tant d’années à ravaler vos larmes, à prétendre que “ça va” alors que ça ne va pas… Il est temps de laisser sortir la douleur pour ne plus qu’elle vous ronge de l’intérieur.
Comment faire ? Dans un premier temps, créez un espace où vous vous sentez en sécurité (seule chez vous, ou avec une personne de confiance ou un thérapeute), et laissez venir ce qui vient. Vous pouvez écouter une musique qui vous émeut, regarder une photo de vous petite, ou simplement fermer les yeux et penser à une situation de rejet marquante. Puis, autorisez-vous à ressentir. Si la tristesse monte : pleurez, sanglotez même s’il le faut – ces larmes sont libératrices. Si c’est de la colère : prenez un coussin et frappez-le, ou criez dans votre voiture, écrivez une lettre de rage (sans l’envoyer). Laissez l’enfant en vous exprimer sa peine, sa colère, son incompréhension.
Beaucoup de personnes ayant la blessure de rejet ont appris à ne pas montrer leurs émotions pour ne pas déranger. Ici, au contraire, vous allez affirmer vos émotions. Vous pouvez dire à voix haute par exemple : « J’en veux à Papa de m’avoir dit ces mots cruels, ça m’a fait si mal ! », ou « J’ai eu tellement de peine quand on m’a exclue à l’école, je me suis sentie inutile… ». Posez des mots sur ce qui brûle à l’intérieur. Cela fait souvent venir les larmes : c’est bon signe. Votre corps libère enfin ce fardeau.
Astuce : Si vous avez du mal à pleurer ou à ressentir (car certaines ont érigé une vraie carapace), essayez de dessiner ou peindre votre douleur, ou de la danser. Le mouvement corporel et la création artistique contournent le mental et peuvent faire remonter des émotions bloquées. Vous pourriez par exemple peindre un grand « NON » en rouge sur une feuille en repensant à un rejet vécu – c’est une manière pour vous de dire « Non, ce n’était pas juste ! » et de reconnaître votre blessure.
4. Apprendre à écouter son corps et ses ressentis
La blessure de rejet, comme toute blessure émotionnelle, s’inscrit aussi dans le corps. Vous avez peut-être remarqué que face à une situation de rejet ou de conflit, votre cœur s’accélère, votre gorge se noue, ou vous ressentez comme un poids sur la poitrine. Le corps ne ment pas : il réagit à nos émotions, même quand notre tête veut les ignorer. Apprendre à écouter les signaux de votre corps vous aidera à désamorcer les réactions de panique et à prendre soin de vous au moment où la blessure se réactive.
Quelques pratiques utiles :
La pleine conscience (mindfulness) : Entraînez-vous chaque jour, quelques minutes, à observer ce qui se passe en vous. Par exemple, le matin au réveil, posez une main sur votre cœur et demandez-vous : « Comment je me sens aujourd’hui ? Qu’est-ce que je ressens dans mon corps ? ». Peut-être un étau dans le ventre, de l’anxiété ? Nommez-le : « je sens de l’anxiété ». Rien que le fait de reconnaître l’émotion lui donne moins de pouvoir. Au contraire, si vous sentez du calme ou de la joie, savourez-le. Cet exercice simple améliore la connaissance de soi.
La psychosomatique : Parfois, notre corps exprime ce que l’on refoule. Posez-vous la question : « Est-ce qu’il y a des douleurs ou symptômes chroniques chez moi qui pourraient être liés à des émotions non exprimées ? » Par exemple, des migraines chaque fois que vous devez vivre une séparation ? De l’eczéma qui s’aggrave quand vous êtes stressée dans vos relations ? Un mal de dos après chaque dispute ? Ce n’est pas “dans votre tête” : l’émotion est bien réelle et le corps la montre. Cela ne veut pas dire que tout est psychosomatique, mais ouvrir cette réflexion peut vous aider à voir quand votre blessure se manifeste de façon détournée, afin d’agir dessus (en parlant, en libérant l’émotion) plutôt que de seulement souffrir physiquement (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?).
Techniques corporelles pour apaiser le système nerveux : La peur du rejet met notre corps en mode “alerte rouge” (système nerveux sympathique activé). Apprendre à activer le mode “relaxation” (parasympathique) est très bénéfique. Vous pouvez essayer des méthodes douces comme la respiration profonde (par exemple 5 secondes d’inspiration, 5 secondes d’expiration, plusieurs fois de suite), la cohérence cardiaque, le yoga doux, le stretching en pleine conscience, ou encore la sophrologie. L’objectif est de montrer à votre corps qu’il est en sécurité ici et maintenant. Une pratique régulière (quelques minutes par jour) vous aidera à ne plus sursauter intérieurement à la moindre crainte de rejet. Vous gagnerez en sérénité et en ancrage.
Consulter des experts corporels : Parfois, un accompagnement professionnel est utile pour libérer les tensions profondes. Des approches comme l’ostéopathie (certains ostéopathes travaillent sur le somato-émotionnel), la réflexologie, l’acuponcture, ou le massage thérapeutique peuvent aider à débloquer des zones où des émotions sont retenues. De même, des thérapies comme la psychomotricité ou la danse-thérapie mettent en lien le corps et la psyché pour guérir les blessures anciennes (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). Choisissez ce qui résonne avec vous : si l’idée d’un cours de yoga vous attire, lancez-vous ; si c’est plutôt un atelier de théâtre (excellent pour exprimer ses émotions et prendre confiance), allez-y. Le tout est de réintégrer votre corps dans le processus de guérison, car la blessure de rejet n’est pas qu’une idée ou une mémoire : c’est aussi un ressenti physique à libérer.
5. Reconstruire son estime de soi pas à pas
Guérir la blessure de rejet passe inévitablement par un travail sur l’estime de soi. Rappelez-vous, cette blessure vous a fait croire que vous ne valiez rien ou pas grand-chose. Il va falloir rééduquer votre regard sur vous-même, pour retrouver une image plus juste, plus bienveillante. 💖
Voici des pistes concrètes pour booster votre estime :
Se parler avec douceur : Finies les insultes envers vous-même (“quelle idiote, j’ai encore raté ça”). Dorénavant, entraînez-vous à vous parler comme à une amie. Par exemple, au lieu de “Je suis nulle d’avoir dit ça”, reformulez “Ok, j’ai peut-être fait une gaffe, mais ça arrive à tout le monde. Ce n’est pas si grave.”. Sur le moment, cela peut sembler artificiel, mais à force de répétition, votre discours intérieur deviendra plus positif.
Faire la liste de ses qualités et réussites : Exercice classique mais puissant : notez 10 qualités que vous avez (si vous séchez, demandez à des proches de vous dire ce qu’ils apprécient en vous, vous serez peut-être surprise !). Notez aussi 10 choses dans votre vie dont vous êtes fière (petites ou grandes victoires : avoir obtenu un diplôme, avoir aidé un ami, savoir bien cuisiner, peu importe). Gardez cette liste et relisez-la souvent, surtout les jours où le moral flanche. Vous avez de la valeur, noir sur blanc.
Oser dire non et poser ses limites : Cela peut sembler paradoxal, mais s’affirmer – même si ça fait peur – est excellent pour l’estime de soi. Chaque fois que vous dites “non” à quelque chose qui ne vous convient pas, vous dites “oui” à vous-même, à votre respect. Commencez par de petites choses : par exemple, oser dire « désolée, je ne pourrai pas venir t’aider samedi » si vraiment vous êtes fatiguée ou occupée, au lieu de vous forcer. Au début, vous aurez peur qu’on vous en veuille (votre blessure va crier “malheur, tu vas les décevoir, ils vont te rejeter”). Mais souvent, non seulement le rejet n’arrive pas, mais en plus vous gagnez en assurance. Vous constatez que votre opinion compte autant que celle des autres. Poser des limites claires envoie aussi un signal aux autres que vous vous respectez – et donc ils vous respecteront davantage.
Prendre du temps pour soi et se chouchouter : Quand on a une piètre estime de soi, on a tendance à s’oublier. “Après tout, je ne mérite pas de prendre du bon temps”, pense-t-on inconsciemment. Il est temps de renverser la vapeur ! Chaque jour, accordez-vous un moment rien qu’à vous, qui vous fait plaisir. Ça peut être 15 minutes de lecture d’un roman qui vous plaît, une balade, un bon bain, peu importe. L’idée est de vous traiter comme quelqu’un qui compte. Plus vous agirez comme si vous aviez de la valeur à vos propres yeux (même si vous n’en êtes pas encore convaincue), plus cette valeur se renforcera en vous. C’est l’effet boule de neige positif. Prenez soin de votre corps aussi : alimentation, sommeil, un peu d’exercice – non pas pour “être parfaite”, mais parce que vous méritez une bonne santé et de l’énergie. Ce faisant, vous envoyez le message à votre cerveau que vous avez de l’importance.
S’entourer de personnes bienveillantes : Rien n’érode plus l’estime de soi que de rester auprès de personnes toxiques qui nous rabaissent ou entretiennent notre insécurité. Faites le point sur votre entourage. Y a-t-il des gens qui profitent de votre peur du rejet pour vous manipuler, ou qui minimisent vos sentiments (« roh t’es trop sensible ») ? Si oui, prenez de la distance avec eux autant que possible (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?) (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). À l’inverse, rapprochez-vous des personnes qui vous apprécient telle que vous êtes, qui vous encouragent. Cela peut être un ou deux amis proches, un membre de la famille, ou même un groupe de soutien (par exemple un atelier de développement personnel où vous vous sentez en confiance). La positivité est contagieuse : plus vous entendrez des discours bienveillants sur vous, plus vous aurez de facilité à y croire. Et souvenez-vous : “Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus”. Choisissez donc des personnes qui reflètent l’amour, le respect et non le rejet.
Reprendre confiance en soi est un travail de chaque jour. Au début, la petite voix critique reviendra souvent (“pfff, tu vois bien que tu n’y arrives pas”). Mais persévérez. Chaque petit pas compte, même celui de se dire le matin “Je mérite de passer une bonne journée”. Vous êtes capable, vous êtes digne, répétez-le-vous. Avec le temps, ces nouvelles pensées forgeront en vous une estime solide, qui fera rempart contre les futurs rejets de la vie. Car oui, on ne pourra jamais empêcher totalement les autres de parfois nous rejeter (on ne peut pas plaire à tout le monde) ; par contre, on peut cesser de se rejeter soi-même, et ainsi ne plus laisser l’opinion d’autrui nous détruire.
6. Changer sa perception du rejet et s’ouvrir aux autres progressivement
Même en travaillant sur soi, il est probable que la peur du rejet se manifestera encore. La différence, c’est que vous allez apprendre à la gérer différemment. Il s’agit ici de rééduquer votre esprit face au rejet, pour ne plus en faire une catastrophe personnelle mais un événement parmi d’autres dans la vie. Quelques clés pour y parvenir :
Relativiser la portée d’un rejet : La prochaine fois que vous vous sentez rejetée (par exemple, on ne vous invite pas à une réunion, ou votre chéri décline une sortie que vous proposiez), essayez de prendre du recul. Posez-vous des questions rationnelles : « Est-ce que ce refus signifie vraiment qu’il/elle ne m’aime plus ? Ou est-ce que ça peut être dû à autre chose (manque de temps, fatigue…) ? » Souvent, on découvre que le rejet qu’on ressent n’est pas un rejet de nous en tant que personne, mais un refus d’une proposition, d’une idée, ou une circonstance indépendante (l’autre est préoccupé, etc.) (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?). Tout le monde, même les personnes sans blessure particulière, vit des refus et des désaccords. Ce n’est pas agréable, mais ça fait partie des interactions normales. En vous répétant « Ce n’est pas MOI qui suis rejetée en bloc, c’est juste que cette situation ne convient pas à l’autre », vous évitez de généraliser et de dramatiser.
Ne pas surinterpréter : Avec la blessure, on a vite fait de surinterpréter négativement le moindre signe. Exercez-vous à demander clairement quand vous doutez, plutôt que de tirer des conclusions hâtives. Par exemple, au lieu de ruminer que votre amie ne vous aime plus parce qu’elle semble distante, appelez-la et dites-lui « Je te sens préoccupée ces derniers temps, est-ce que tout va bien ? ». Vous pourriez apprendre qu’elle a des soucis personnels qui n’ont rien à voir avec vous. En communiquant, vous évitez de tomber dans le piège de l’interprétation erronée. Et si effectivement il y a un problème entre vous, vous pourrez en discuter franchement.
S’exposer progressivement à la “peur du non” : Cela peut être un jeu (presque une désensibilisation). Donnez-vous des petits défis où vous risquez un rejet, pour muscler votre tolérance. Par exemple, demander un service anodin à un inconnu (demander son chemin, ou même demander une ristourne dans un magasin pour s’amuser) – s’il dit non, vous verrez que ce n’est pas la fin du monde et que vous pouvez survivre à un “non”. Ou entamez une conversation avec quelqu’un que vous connaissez peu. Bref, sortez doucement de votre zone de confort sociale. Chaque interaction réussie vous donnera confiance, et chaque refus essuyé vous prouvera que cela ne vous détruit pas. Vous gagnerez en résilience face au rejet. Certains coachs recommandent même de cumuler les “non” : par exemple, tenter quelque chose de difficile jusqu’à obtenir 5 refus dans la semaine. L’idée est de dédramatiser le non : après tout, ce n’est qu’un mot ou une situation, ce n’est pas vous.
Cultiver l’indépendance émotionnelle : Cela va de pair avec l’estime de soi. Plus vous vous sentez complète par vous-même, moins le rejet des autres aura de prise sur vous. Travaillez à être bien en votre propre compagnie. Développez des passions, des activités où vous vous épanouissez seul(e). Ainsi, votre bonheur dépendra moins de l’attention extérieure. Ce n’est pas de l’auto-suffisance hautaine, c’est de l’équilibre. Quand on se sent bien avec soi, on aborde les autres avec moins d’attente désespérée – donc paradoxalement, on subit moins de rejets car on est plus détendue et naturelle. Et si rejet il y a, on se dit « tant pis pour lui/elle, moi je sais qui je suis et je continuerai ma route ».
(Rejected Pictures | Download Free Images on Unsplash) Une femme les yeux fermés, dans une posture calme de profil – symbolisant l’introspection et la paix intérieure retrouvée en travaillant sur soi.
7. Se faire accompagner si besoin (thérapie, groupe de parole)
Guérir d’une blessure émotionnelle profonde peut être un chemin complexe. Vous n’êtes pas obligée de le parcourir seule. Demander de l’aide est même un acte de courage et d’amour envers soi. Si vous sentez que la souffrance est trop lourde, ou que malgré vos efforts vous tournez en rond, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel de l’accompagnement psychologique (Blessure de rejet : c’est quoi, comment guérir ?).
Plusieurs options :
Un(e) psychologue ou psychothérapeute : Formé(e) pour écouter sans jugement et vous aider à mettre en place des stratégies pour aller mieux. En thérapie, vous pourrez explorer en profondeur votre blessure, dans un cadre sécurisant. Un bon thérapeute vous aidera à reprogrammer vos schémas de pensée, à guérir votre enfant intérieur, et vous apportera le soutien émotionnel qui vous a manqué. Il ou elle pourra utiliser différentes approches : thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour travailler sur les pensées automatiques de rejet, l’EMDR si un traumatisme précis est à l’origine de la blessure, la thérapie des schémas, etc. Choisissez quelqu’un avec qui vous vous sentez en confiance : la relation thérapeutique elle-même, basée sur l’acceptation inconditionnelle, est réparatrice (vous faites l’expérience d’être écoutée et acceptée pleinement).
Des groupes de parole ou ateliers : Parfois, rencontrer d’autres personnes qui vivent la même chose peut être très libérateur. Il existe des groupes de parole sur l’estime de soi, sur les blessures émotionnelles, ou même des forums en ligne. Partager vos expériences et entendre celles des autres vous fera réaliser que vous n’êtes pas seule, et que vos réactions sont compréhensibles. De plus, en groupe bienveillant, on peut s’exercer à des interactions sans peur du rejet car chacun connaît la sensibilité de l’autre. Veillez juste à des groupes encadrés par un pro ou animés de façon constructive (pas juste un “déballage” sans solution), pour en tirer un vrai bénéfice.
Lire des ouvrages et se documenter : Continuer à vous informer est excellent pour votre processus. Lise Bourbeau a popularisé ces concepts dans ses livres, mais d’autres auteurs peuvent vous aider. Par exemple, le livre “Ces blessures qui nous empêchent d’aimer” (auteur fictif) ou des podcasts sur la peur du rejet. Parfois, une phrase lue va faire tilt et vous faire avancer d’un coup. Attention toutefois à ne pas juste accumuler du savoir sans le mettre en pratique. La guérison passe par l’expérience réelle (émotionnelle, relationnelle). Utilisez les lectures comme un complément, une source d’inspiration et d’outils, mais n’oubliez pas de vivre les changements dans votre quotidien.
Il n’y a pas de honte à se faire aider. On ne vous trouvera pas faible – au contraire, c’est une démarche saine et mature. Et si une personne vous juge pour ça, eh bien… c’est qu’elle ne comprend pas votre démarche, peut-être parce qu’elle-même a peur de regarder ses propres blessures. Choisissez votre bien-être avant l’opinion de ceux qui ne vivent pas dans votre peau. 🙏
8. Pratiquer l’auto-compassion et le pardon (de soi et des autres)
La guérison véritable de la blessure de rejet passe par le pardon – un mot parfois difficile à entendre quand on a souffert. Pardonner ne signifie pas que ce que l’autre a fait est acceptable, ni que ça n’a pas d’importance. Cela signifie se libérer soi-même du poison du ressentiment et de la culpabilité. Et il y a deux pardons essentiels ici : se pardonner à soi-même, et pardonner (éventuellement) à ceux qui ont participé à la blessure.
Se pardonner à soi : Beaucoup de femmes souffrant de rejet portent en elles une culpabilité diffuse. Par exemple : « Si j’ai été rejetée, c’est que je l’ai mérité… J’ai dû être une mauvaise fille, une mauvaise compagne… » Ou bien elles se reprochent leurs comportements de protection : « J’ai gâché telle relation en fuyant, c’est de ma faute si je suis malheureuse ». Il est temps de vous pardonner ces soi-disant “erreurs” ou “faiblesses”. Vous avez fait du mieux que vous pouviez pour survivre émotionnellement. Fuire ou saboter, c’était votre manière de vous protéger. Remerciez-vous d’avoir trouvé ces stratégies à une époque – elles vous ont aidée à tenir. Et dites-vous que maintenant, vous n’en avez plus besoin autant, vous pouvez apprendre d’autres façons. Pardonnez-vous d’avoir cru que vous ne valiez rien : vous aviez tort, mais ce n’était pas conscient. Pardonnez à la petite fille en vous d’avoir pensé que le monde serait mieux sans elle. Elle ne savait pas, elle avait mal. Vous n’êtes pas responsable du mal qu’on vous a fait étant enfant, et à présent adulte, vous reprenez les rênes avec bienveillance envers vous-même.
Pardonner aux autres (optionnel et à votre rythme) : Pardonner à celui/ceux qui vous ont fait ressentir le rejet est plus ardu. Et ce n’est pas obligatoire pour guérir, mais cela peut y contribuer fortement. Comprendre l’histoire de vos parents par exemple peut amener du pardon : réaliser que votre mère elle-même n’avait pas reçu d’amour et ne savait pas en donner, ou que votre père a agi par ignorance, pas par volonté de nuire. Pardonner, ce n’est pas excuser, c’est dire : « Je choisis de ne plus alimenter la rancune. Je libère cette énergie négative, pour avancer. » Vous pouvez imaginer mentalement dire à la personne : « Je te pardonne de ne pas avoir su m’aimer comme j’en avais besoin. Je me libère de cette blessure. » Cela peut être très émouvant. Parfois, on n’y arrive pas du premier coup, surtout si la blessure est encore vive. Ne forcez rien. Le pardon peut venir après un certain cheminement, quand vous vous sentez suffisamment solide. Et pardonner ne veut pas forcément dire renouer. Vous pouvez pardonner dans votre cœur un parent décédé ou absent, juste pour votre paix intérieure. Faites-le surtout pour VOUS, pour ne plus être prisonnière du passé.
L’auto-compassion est un concept essentiel : il s’agit d’être aussi gentille envers vous-même que vous le seriez envers une amie proche. À chaque étape de ce parcours, pratiquez l’auto-compassion. Par exemple, si vous retombez dans un vieux travers (ex : vous fuyez un prétendant par peur), plutôt que de vous blâmer, dites : « Ok, j’ai encore ce réflexe de protection, c’est humain. Je me comprends. La prochaine fois, j’essaierai d’affronter un peu plus. Je me donne du temps. » Encouragez-vous, consolez-vous. Ce reparentage de vous à vous est très réparateur.
9. Être patiente et célébrer chaque progrès
Enfin, rappelez-vous que guérir prend du temps. C’est un processus en zigzag, avec des avancées et parfois des rechutes. Ne vous découragez pas si, après quelques semaines où tout allait mieux, vous ressentez à nouveau fortement la peur du rejet suite à un événement. Cela ne veut pas dire que vous n’avez pas avancé. Au contraire, vous avez désormais conscience de ce qui se passe, et vous pouvez utiliser vos nouvelles ressources pour mieux le vivre qu’avant.
Chaque petite victoire compte et mérite d’être célébrée 🎉. Par exemple :
Vous avez osé exprimer un désaccord à une amie, et – oh surprise – elle l’a bien pris et est toujours votre amie ? Bravo ! C’est une réparation symbolique : vous voyez qu’on peut s’affirmer sans être rejetée.
Vous avez arrêté de vous excuser pour tout pendant une journée ? Félicitez-vous : « J’ai du respect pour moi-même, et ça se voit. »
Vous avez ressenti du rejet mais au lieu de pleurer toute la nuit, vous avez appelé une personne de confiance pour en parler ou écrit dans votre journal, et vous vous êtes senti apaisée après ? Super : vous gérez vos émotions de façon plus saine.
Chaque progrès, même minime, est une brique qui renforce votre reconstruction. Il y aura peut-être des jours “sans”, où la vieille douleur refait surface intensément. Ces jours-là, plutôt que de paniquer en croyant repartir à zéro, dites-vous que c’est comme une cicatrice qui tiraille par temps humide : ce n’est pas une réouverture totale de la plaie, juste un rappel. Dans ces moments, reprenez vos notes, vos outils (respiration, écrire, etc.), entourez-vous de douceur, et constatez : vous la traversez probablement mieux qu’avant.
Enfin, n’hésitez pas à poser des intentions positives pour l’avenir. Par exemple : « Je m’ouvre à des relations saines et nourrissantes où je me sens acceptée. J’attire à moi des personnes qui m’apprécient pour qui je suis. Je mérite l’amour et je l’accueille dans ma vie. » Cela peut sembler un peu mantra au début, mais le cerveau est réceptif aux affirmations répétées. Vous reprogrammez ainsi progressivement votre esprit à envisager un futur plus lumineux, plutôt que de rester bloquée dans le sombre passé.
Illustration symbolique : un oiseau s’échappant d’une cage ouverte. Il représente la libération de soi et le courage de s’envoler vers la liberté émotionnelle, une fois la blessure de rejet apprivoisée.
En conclusion, la blessure de rejet n’est pas une fatalité. Oui, elle a marqué votre histoire, parfois au fer rouge. Mais elle peut devenir une formidable occasion de grandir et d’apprendre à vous aimer davantage. Beaucoup de personnes qui guérissent de cette blessure en ressortent plus fortes, empathiques et conscientes de leur valeur. C’est tout le bien que je vous souhaite 💞. Prenez soin de vous, avancez un pas à la fois, et souvenez-vous : vous n’êtes pas seule sur ce chemin. Chaque lecture de cet article, chaque exercice tenté, chaque émotion libérée est une victoire sur le rejet et un pas vers la renaissance de la femme confiante et aimante que vous méritez d’être.
(Maintenant, respirons un grand coup… Vous venez de parcourir un long voyage intérieur à travers ces lignes. Accordez-vous un instant pour ressentir ce qui se passe en vous. Peut-être de l’espoir, de l’apaisement, ou même une légère appréhension – tout est OK. Rappelez-vous : vous méritez le bonheur et l’amour. Il est temps d’y croire. 🤗)
Foire Aux Questions (FAQ) sur la blessure de rejet
Q1. Qu’est-ce que la “blessure de rejet” en termes simples ?
R: C’est une douleur émotionnelle profonde née du sentiment d’avoir été rejeté ou non accepté, souvent vécue dans l’enfance. En termes simples, c’est comme une cicatrice intérieure laissée par des expériences où vous vous êtes senti exclu, pas aimé ou indésirable. Cette blessure vous fait croire, à tort, que vous ne méritez pas l’amour ou que vous avez “quelque chose qui cloche”. Elle peut ensuite influencer toute votre vie en vous faisant craindre de revivre du rejet sans arrêt.
Q2. Comment savoir si je souffre de la blessure de rejet ?
R: Plusieurs signes peuvent vous alerter : une très faible estime de vous (vous vous dénigrez souvent), une peur panique d’être rejetée ou abandonnée (vous voyez du rejet partout, êtes hyper-sensible aux critiques ou aux refus), et des comportements de fuite (vous prenez peu de place, évitez les conflits, vous coupez des relations par peur d’être blessée). Vous pouvez aussi vous sentir chroniquement seule même entourée. Si plusieurs de ces descriptions vous correspondent et que cela vous fait souffrir, il y a de fortes chances que cette blessure de rejet soit présente en vous.
Q3. D’où vient cette blessure ? Est-ce forcément la faute des parents ?
R: La blessure de rejet prend généralement racine dans l’enfance. Ce n’est pas forcément “la faute” intentionnelle des parents – souvent, ils ne se rendent pas compte de l’effet de certaines situations. Elle peut venir de nombreuses choses : un parent froid ou très critique, un sentiment d’abandon (par ex. hospitalisation, séparation, divorce), des moqueries à l’école, un contexte où l’enfant ne se sentait pas à la hauteur des attentes. Parfois, un parent lui-même porteur de cette blessure la transmet involontairement (par un manque d’affection, des paroles maladroites). Donc, oui, elle vient souvent des premières relations (famille généralement), mais c’est plus la perception de l’enfant qui crée la blessure que la volonté de blesser de l’entourage.
Q4. Blessure de rejet et blessure d’abandon, est-ce la même chose ?
R: Ces deux blessures se ressemblent et sont souvent confondues, mais il y a une nuance. La blessure d’abandon survient quand on a manqué de présence, qu’on a été laissé de côté (sentiment d’être abandonné physiquement ou émotionnellement). La blessure de rejet est plus liée au fait de se sentir repoussé dans son être, carrément nié ou non voulu. Pour imager : l’abandon c’est « on ne s’est pas occupé de moi », le rejet c’est « on n’a carrément pas voulu de moi / on m’a repoussé(e) ». Les deux peuvent coexister (par ex., un parent qui part = abandon, et l’enfant peut le vivre comme “il ne voulait pas de moi” = rejet). En général, la blessure de rejet est encore plus profonde dans l’identité : la personne se sent “de trop” sur Terre, alors que dans l’abandon la personne se sent “seule et pas soutenue”. Les comportements diffèrent aussi : face à l’abandon, on aura tendance à la dépendance affective (peur de la solitude), face au rejet, on aura tendance à fuir et se faire tout petit (peur d’être jugé nul).
Q5. Peut-on vraiment guérir d’une blessure émotionnelle aussi profonde ?
R: La bonne nouvelle : OUI, on peut la guérir ou du moins la cicatriser fortement. Par “guérir”, on entend ne plus laisser cette blessure diriger votre vie et vos émotions comme avant. Vous réussirez à ne plus vous définir par le rejet, à ne plus en avoir une peur panique. Par contre, il est possible qu’il en reste une petite sensibilité (comme une cicatrice qui reste un peu sensible, mais ne fait plus mal tous les jours). Beaucoup de personnes témoignent qu’avec un travail sur soi, elles vivent aujourd’hui sereinement, sans que la peur du rejet ne les empêche d’aimer, de s’affirmer et d’être heureuses. Le processus prend du temps et demande de la patience et de la bienveillance envers soi, mais il en vaut vraiment la peine. Vous en ressortirez plus forte et libre.
Q6. Combien de temps faut-il pour guérir de la blessure de rejet ?
R: Il n’y a malheureusement pas de durée universelle. Cela dépend de l’histoire de chacun, de l’intensité de la blessure et des moyens mis en œuvre pour la guérir. Pour certains, quelques mois de thérapie et de travail personnel apportent déjà un immense soulagement et des changements concrets. Pour d’autres, c’est un chemin sur plusieurs années, par étapes. L’important est de respecter votre rythme. Ne vous découragez pas si cela prend du temps : chaque petite avancée compte. Voyez cela comme un processus de croissance personnelle plutôt qu’une course avec une ligne d’arrivée. Même une fois### Q6. Combien de temps cela prend-t-il de guérir de cette blessure ?
R: Il n’y a pas de durée fixe – c’est très variable d’une personne à l’autre. Pour certaines, quelques mois de travail sur soi (par exemple en thérapie ou développement personnel) apportent déjà un soulagement notable. Pour d’autres, le processus peut durer des années, avec des paliers de progression. L’important est de ne pas se comparer et de respecter votre rythme. Voyez cela comme un cheminement, pas après pas. Même une fois que vous irez beaucoup mieux, il faudra sans doute rester vigilante aux vieux schémas qui pourraient ressurgir en période de stress. Guérir, c’est un peu comme la rééducation après une blessure physique : on renforce petit à petit de nouveaux muscles (émotionnels dans ce cas) et on accepte que la patience fait partie du voyage. Chaque étape franchie est une victoire !
Q7. Comment la blessure de rejet affecte-t-elle la vie amoureuse ?
R: Cette blessure peut malheureusement saboter la vie sentimentale si elle n’est pas consciente. En amour, la personne qui en souffre peut avoir peur de s’engager (de crainte d’être rejetée plus tard) ou au contraire tomber dans la dépendance affective par peur d’être quittée. Concrètement, cela peut donner : une jalousie ou insécurité intense (« Il/elle va me quitter, je ne suis pas assez bien »), une tendance à tester l’autre sans cesse pour se rassurer, ou à fuir dès que la relation devient sérieuse (« Mieux vaut partir avant de trop souffrir »). Paradoxalement, on peut être attiré par des partenaires « qui font mal » : indisponibles, froids, ou égocentrés – car inconsciemment, cela conforte le schéma de rejet que l’on connaît. La bonne nouvelle, c’est qu’en travaillant sur vous, vous pouvez tout à fait vivre une relation de couple épanouie et sécurisante. Beaucoup de personnes ayant guéri cette blessure témoignent qu’elles ont ensuite attiré des partenaires plus bienveillants, et su construire avec eux une confiance mutuelle. L’amour sain est possible, et même réparateur : être aimée pour de vrai aide à cicatriser les blessures passées.
Q8. Peut-on avoir plusieurs blessures émotionnelles en même temps ?
R: Oui, c’est possible. Lise Bourbeau a identifié 5 blessures de l’âme (rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice), et nous portons souvent un mélange de plusieurs, avec généralement une ou deux prédominantes. Par exemple, beaucoup de personnes ont à la fois la blessure de rejet ET d’abandon (la peur d’être rejetée et la peur de se retrouver seule). Ou rejet et injustice, etc. Ces blessures peuvent s’entrecroiser dans nos comportements. L’important est de voir lesquelles sont activées chez vous. Souvent, en travaillant sur l’une, on agit aussi sur les autres car elles ont des racines communes dans le manque d’estime de soi et de sécurité. Ne vous étonnez donc pas si en creusant, vous vous reconnaissez aussi dans d’autres blessures. Priorisez celle qui vous fait le plus souffrir actuellement (si c’est le rejet, concentrez-vous là-dessus). Vous démêlerez le reste petit à petit. Tout est lié de toute façon : en gagnant de la confiance en vous et de l’amour-propre, vous apaisez plusieurs blessures à la fois.
Q9. Comment aider quelqu’un qui a une blessure de rejet (par ex. mon/ma partenaire) ?
R: Si vous avez identifié chez un proche (conjoint, ami…) des comportements qui ressemblent à cette blessure, la meilleure chose à faire est de lui offrir écoute, assurance et patience. Concrètement :
Évitez les phrases du type “Tu es trop sensible” ou “Arrête de te faire des films”. Au contraire, validez ce qu’il/elle ressent (“Je comprends que tu aies eu peur que je te rejette en disant cela. Mais ce n’était pas mon intention, je t’assure que je tiens à toi.”).
Communiquez clairement et rassurez souvent, surtout au début. Par exemple, si votre partenaire se vexe ou se renferme soudain, au lieu de le prendre mal, dites-lui calmement “Je sens que tu as été blessé(e) par ce qui s’est passé. Je veux que tu saches que je t’aime comme tu es, je ne te rejette pas du tout.”. Parfois, une simple étreinte et des mots doux suffisent à apaiser sa panique intérieure.
Ne le/la forcez pas à changer à toute vitesse. Vous pouvez suggérer de l’aide (thérapie, lecture) s’il/elle est réceptif(ve), mais sans imposer. Montrez juste que vous êtes là, que vous ne partirez pas au premier orage émotionnel. Avec le temps, en faisant preuve de fiabilité, vous aiderez cette personne à reconstruire sa confiance.
Posez aussi vos limites : aider ne veut pas dire tout accepter. Si des accusations injustes ou des comportements de fuite vous font souffrir, exprimez-le posément (“Quand tu te renfermes sans m’expliquer, ça me rend triste car j’ai l’impression de ne pas pouvoir t’aider. Parle-moi, s’il te plaît.”). Encouragez-le/la à communiquer ses peurs plutôt que de réagir par des extrêmes.
En résumé, pour aider quelqu’un avec une blessure de rejet : beaucoup de réassurance, de la compréhension, et une communication sincère. Vous ne pourrez pas guérir à sa place, mais votre soutien peut faire une énorme différence. N’oubliez pas de vous protéger aussi émotionnellement, car ce n’est pas toujours facile d’être en face – d’où l’importance qu’il/elle entreprenne aussi un travail personnel.
Q10. Quels sont les outils ou ressources recommandés pour guérir cette blessure ?
R: En plus de la thérapie individuelle, voici quelques ressources utiles :
Livres : “Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même” de Lise Bourbeau (incontournable pour comprendre le concept de blessure de rejet et les autres). Vous pouvez aussi lire des ouvrages sur l’estime de soi (par ex. “Imparfaits, libres et heureux” de Christophe André), ou sur l’auto-compassion (“S’aimer : comment se réconcilier avec soi-même” de Lowen, ou les travaux de Kristin Neff sur l’autocompassion). Ces lectures offrent des pistes concrètes et des exercices.
Podcasts/VidÉos : Il existe des podcasts de psychologues ou coachs abordant la peur du rejet, la dépendance affective, etc. Cherchez par mots-clés “blessure de rejet”, “peur du rejet” sur YouTube ou Spotify par exemple. Entendre des spécialistes en parler peut vous apporter des déclics et vous faire sentir comprise.
Groupes de soutien en ligne : Des forums ou groupes Facebook dédiés au développement personnel, à l’hypersensibilité ou aux blessures de l’âme peuvent permettre d’échanger avec d’autres. Partager vos progrès, poser des questions, lire les témoignages – tout cela peut motiver et donner le sentiment d’une communauté bienveillante. (Toujours garder du recul et esprit critique, mais bien utilisé, un groupe de ce type peut soutenir votre démarche).
Techniques de libération émotionnelle : On a mentionné plus haut le yoga, la méditation, etc. D’autres outils comme l’EFT (Emotional Freedom Technique), qui consiste à tapoter des points d’acupuncture tout en verbalisant ses peurs, peuvent être étonnamment efficaces pour apaiser rapidement l’angoisse de rejet. De même, la pratique régulière du journal intime (écrire chaque soir ce que vous avez ressenti dans la journée, vos petites victoires et vos difficultés) vous aide à y voir clair et à mesurer vos progrès.
Enfin, n’hésitez pas à vous entourer de professionnels complémentaires : par exemple un coach en développement personnel pour vous fixer des objectifs et vous booster, en plus d’un psy pour le travail en profondeur. Chacun ses affinités : certains préfèreront un stage de développement personnel en groupe, d’autres une thérapie en tête-à-tête. L’important est que vous trouviez les outils qui vous parlent le plus et que vous passiez à l’action, un petit pas après l’autre.
Le mot de la fin : La blessure de rejet peut faire très mal, mais ce n’est pas une fatalité. C’est un appel à vous aimer davantage et à guérir votre enfant intérieur. En lisant cet article jusqu’au bout, vous avez déjà montré votre courage et votre envie de changer les choses – bravo. 🌟 Continuez sur ce chemin avec bienveillance envers vous-même. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous apporter l’amour que vous méritez et d’oser le recevoir des autres. Vous méritez d’être aimée, ne l’oubliez jamais. Bonne route vers la guérison ❤️.